3
oct.
2007
J'ai déjà mentionné ici la manière discutable dont les résultats scientifiques sont communiqués aux journalistes scientifiques : sous condition d'embargo, c'est-à -dire que ces derniers doivent préparer leur enquête et leur article mais ne rien publier avant leurs autres collègues, d'où une explosion d'articles (et souvent de superlatifs) le jour J. Sauf exception, comme en 1997 quand The Observer a brisé l'embargo pour publier le scoop de la première brebis clonée, Dolly.
Mais cette pratique immémoriale est peut-être plus que jamais sous le feu des critiques. En 2006, Vincent Kiernan du Chronicle of Higher Education publiait une enquête approfondie aux presses de l'université d'Illinois : non content de dénoncer ces pratiques de collusion, son livre offre une exploration sans précédent de l'impact de l'embargo sur la culture scientifique du public et les questions médicales
. Après avoir passé en revue 25 quotidiens américains et s'être entretenu avec les journalistes scientifiques, il conclut que ce système favorise le "journalisme en bande" et crée un obstacle néfaste à la compétition journalistique, favorisant une couverture complaisante de l'actualité scientifique et médicale à partir d'une poignée de sources-clés.
Puis nul autre que le rédacteur en chef du fameux Lancet, dans son compte-rendu de lecture du livre de Kiernan paru dans Science, y allait de son couplet : l'embargo est d'abord une demande des journalistes, avant que les éditeurs des revues scientifiques n'y voient l'avantage qu'ils pouvaient en tirer. L'embargo est artificiel, il favorise la survie des journalistes les moins doués, il attire l'attention sur des résultats souvent faibles et douteux. L'existence de cette "bande de journalistes" guidés par l'embargo devrait être antithétique d'une profession qui résiste habituellement à toute pression extérieure.
Selon lui, la disparition de l'embargo fera du bien à tout le monde. Mais quelle revue osera la première ?
Il y a deux mois, c'est un ancien journaliste scientifique de la BBC qui enfonçait le clou. Extraits choisis :
C'est quelque chose que les journalistes ne devraient pas faire mais que nous faisons tous, volontairement, parce que nous n'avons pas le choix si nous voulons rester connectés au flux régulier des nouvelles des revues. Aucun autre domaine du journalisme n'a un tel arrangement confortable et dissimulé. (…) Les revues disent que l'embargo est une bonne chose. Ils disent que cela nivelle vers le haut la couverture des recherches sérieuses qui ont été approuvées par les pairs. Ils ajoutent que cela permet aux journalistes de travailler leurs articles, conduire les interviews et filmer, afin qu'ils comprennent bien la science sous-jacente. Tout ça, c'est du pipeau et de la condescendance.
Je suis prêt à parier que le débat va continuer mais que l'embargo finira par céder sous ces coups de butoir, ainsi que sous ceux des blogueurs. En effet, ces derniers se posent aujourd'hui comme complément sérieux au journalisme scientifique et revendiquent eux aussi un droit à l'information : pourquoi seraient-ils ainsi exclus, à plus forte raison quand l'embargo expire avant la date de publication réelle de l'article scientifique et que, ne pouvant y accéder, ils sont dans l'impossibilité de se livrer à leur exercice favori du commentaire… Pour le salut de la liberté d'informer, espérons que cette situation cessera rapidement !

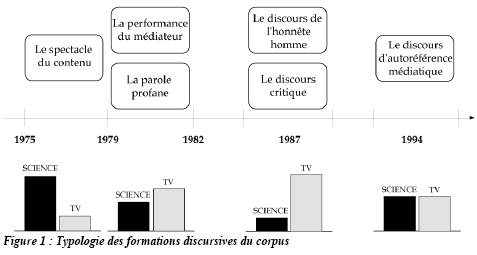


Derniers commentaires